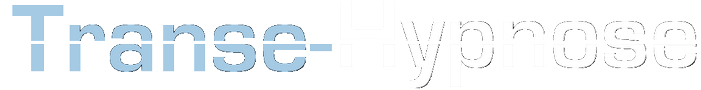pour monsieur paulelie:
Nous étudierons comment ce symptôme de bégaiement est la représentation de l’enfant mis en place d’objet de la mère là où le père n’introduit pas une fonction de mise à distance du désir de la mère.
Le symptôme de l’enfant peut, dit Lacan, « représenter la vérité du couple familial [1] » et « se trouver en place de répondre à ce qu’il y a de symptomatique dans la structure familiale [2] ». Je propose d’illustrer, à travers le cas d’un jeune garçon, âgé de 8 ans, amené en consultation par ses parents pour un bégaiement, comment ce symptôme est la représentation de l’enfant mis en place d’objet de la mère, là où le père n’introduit pas une fonction de médiation, de mise à distance du désir de la mère sur l’enfant.
Quand, dans le cadre d’une consultation médico-psycho-pédagogique, je rencontre, pour la première fois, Peter accompagné par ses parents, il est scolarisé en ce2. Dès la maternelle, il est suivi pendant trois ans par une orthophoniste, en privé, pour un retard de langage, puis pour des problèmes de dyslexie qui se sont résolus, tandis qu’un bégaiement, apparu en cp, persiste actuellement et motive la nouvelle démarche chez le psychanalyste. Une psychologue, consultée en ville auparavant, aurait situé les troubles en réaction à l’autorité. La mère impliquée, semble-t-il, par ce rapprochement, ajoute : « Je suis exigeante » y associant la maîtresse de cp qui, dit-elle, était très sévère.
Le père, qui se tient apparemment plus en retrait (« je ne suis pas souvent là », dit-il), interroge autrement le symptôme de son fils : d’après lui, Peter souffre de timidité et craint les moqueries des autres. Le père signale toutefois que lors de l’entretien avec la psychologue, Peter n’a pas bégayé, ce à quoi Peter rétorque : « Si une fois », montrant par là qu’il tient à son symptôme ; il n’est pas prêt d’y céder si vite.
Au rendez-vous suivant, Peter est accompagné de sa maman qui, distante, fuyante, centre ses propos sur la question scolaire et son insatisfaction concernant l’horaire proposé. Elle ne supporte pas que Peter rate l’école alors qu’il est déjà « si stressé ». D’emblée, « ça ne colle pas ». On ne répond pas à ses exigences bien qu’elle se présente sous ce trait : « Je suis exigeante. »
En présence de sa mère, Peter se tait. Apparemment, le fait de manquer ou non une heure d’école n’est pas son problème. Reçu seul, il ne parle pas davantage ; il répond aux questions posées par une ou deux phrases courtes émaillées de « je ne sais pas » qui l’arrêtent, si je tente d’obtenir quelques informations ou précisions supplémentaires. Il ne bégaye pas mais son discours est pauvre, hésitant, peu fluide. Passif, statique, Peter ne cherche pas non plus à utiliser le matériel mis à sa disposition et refuse de dessiner. En revanche, les variations fréquentes de son teint, oscillant sans cesse entre pâleur et rougissement, laissent apparaître une émotivité à fleur de peau, en deçà des mots. Par ailleurs, ses choix d’activités extrascolaires l’orientent quasi exclusivement vers ce qui ne le confronte pas directement aux autres : le vélo, la gymnastique, la pêche avec son frère aîné dans la propriété de son grand-père maternel où il se rend chaque été.
La semaine suivante, Peter vient avec son père qui, en dépit de ses activités professionnelles, a pu se libérer. Allant droit au but, il demande que « j’aide son fils ». Or, là encore, ne disposant pas d’une technique, d’un savoir tout prêt qui aurait mis en confiance les parents, je ne peux répondre où ils m’attendent. Mais n’est-ce pas dans cet écart qu’un espace se creusera où pourront venir se loger les dires de l’enfant et de ses parents ?
Évitement des conflits chez le père
De fait, le père émet ses hypothèses. Pour lui, « Peter est un enfant adorable, serviable, gentil, mais, comme lui, il redoute les conflits, a peur de l’échec et de se faire gronder ». Si Peter n’est pas franchement d’accord avec les propos de son père qu’il module par de petites phrases telles que : « Parfois oui, parfois non », il ne peut toutefois s’exprimer davantage, comme s’il était bloqué… Qu’est-ce qui le retient ? Que contient-il ? Est-ce de l’agressivité pour ce père trop proche, identifié à ses problèmes ? Freud démontre que dans la phobie du petit garçon, la motion pulsionnelle refoulée est une motion hostile envers le père. Refoulée, elle est transformée. À la place de l’agression contre le père vient celle contre le sujet lui-même. L’analyse du petit Hans [3], en suivant à la trace la provenance de l’idée du cheval qui mord, en fournit la preuve. Hans voit tomber un cheval. Or, il a vu tomber et se blesser un camarade de jeu avec qui il a joué au cheval. À partir de là, Hans construit la motion de souhait suivante : « Puisse le père tomber et se faire mal comme le cheval et le camarade [4]. » La visée d’éliminer le père est équivalente à la motion meurtrière du complexe d’Œdipe. Hans aime sa mère et devrait avoir une haine meurtrière contre son père. Mais au lieu de cela survient l’angoisse d’être agressé. Or, pour Hans qui n’a pas peur de son père, la peur se reporte sur le cheval, substitut du père, qui va mordre. « Ce déplacement, dit Freud, instaure ce qui peut revendiquer le nom de symptôme [5]. » De plus, parallèlement au remplacement du père par le cheval, il n’y a plus trace de l’attachement de Hans pour sa mère. Mais cette phobie conduit Hans à l’empêchement de sortir.
Ici, le bégaiement (retenir les mots, buter, inhiber l’expression orale) a-t-il le statut d’une inhibition phobique avec ce double mouvement pulsionnel : agression sadique contre le père, puis inversion et adoption par l’enfant de la position passive tendre envers le père comme lui trop gentil, n’aimant pas élever la voix ? « Je pense que ça ne sert à rien, je préfère trouver d’autres solutions ; je n’aime pas foncer dans le mur. » Réfugié dans l’évitement, le père ne gronde pas mais cajole. En effet, Peter, dernier d’une fratrie de trois, s’attire les « chouchouteries » de tous, y compris de son père. En revanche, hors de la présence de ses parents, Peter confie sa peur de se faire gronder par sa mère, quand il écrit mal, et de devoir recommencer. Entre un père qui a le phallus mais craint de le perdre en montrant qu’il l’a et une mère qui ne l’a pas mais, en grondant, fait croire qu’elle l’a, l’enfant est coincé dans le filet de la problématique de ses parents.
Comment démêler cet embroglio dans lequel l’enfant se trouve empêtré ?
Dans le cas du petit Hans, l’agression contre le père se retourne en angoisse que le cheval le morde, angoisse qui peut se compléter de celle que le cheval le castre, lui arrache l’organe génital en le mordant. L’angoisse est liée à la menace de castration. À quel moment surgit-elle ? Au moment, dit Freud, où le petit garçon rencontre la castration de sa mère.
Dans les Trois essais sur la sexualité [6], Freud met en évidence trois temps :
premier temps : les petites filles et les petits garçons partagent cette croyance que tous ont un pénis ;
deuxième temps : la découverte que quelques-unes ne l’ont pas est niée chez le petit garçon ;
troisième temps : le petit garçon découvre que sa mère n’a pas le phallus. Cette découverte est imputée au père. Il en déduit que lui aussi peut être frappé de la castration. Il renonce ainsi à sa mère pour échapper à ce risque et sort de l’œdipe par identification au père. La reconnaissance que ce n’est pas lui, petit garçon, qui l’a, mais le père, suppose un renoncement à l’avoir pour pouvoir le donner ultérieurement. Pour l’avoir, il faut renoncer à l’avoir. Ainsi, pour le petit garçon, être aimé du père, cajolé, en position passive, peut avoir comme conséquence le risque de perdre ses organes génitaux qui le différencient de la femme. Dans la phobie, le moteur du refoulement est l’angoisse de castration.
Lors des quelques séances qui vont suivre l’entretien avec le père, Peter arrive à deux reprises avec le pouce bandé. Par ailleurs, il fait allusion à son vélo cassé qu’il ne sait pas réparer. Il mentionne également son dégoût pour la construction d’un cerf-volant dont le bâton central est cassé. On note d’autre part que le bégaiement est apparu au moment particulièrement difficile pour lui de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture qui, très probablement, l’a confronté à l’horreur du trou, en l’occurrence ici le trou dans le savoir. On relève aussi que Peter bégaye en séance lorsqu’il se risque à enchaîner des phrases les unes après les autres, donnant libre cours à sa pensée. Il bute alors sur chaque mot, il coupe… comme si quelque chose lui interdisait de laisser dire… Ces éléments indiquent sans doute un rapport à la castration voilée, masquée.
Une brèche s’ouvre pour la mère
Après les congés d’été, nouveau rebondissement, la maman vient seule à la consultation. Elle se plaint de ce que « ça ne colle toujours pas entre elle et moi ». « Je n’ai pas le feeling avec vous, vous ne me comprenez pas. Je ne vous ressens pas, je n’ai pas le contact, vous ne vous mettez pas à ma place. J’attendais que vous me donniez des conseils, que vous me disiez ce que je dois faire, et vous ne me dites rien. »
À partir de cette inadéquation – je ne suis pas la thérapeute qu’elle a imaginée pour son fils – un espace se creuse encore mais avec risque de rupture. Elle est prête à demander à rencontrer quelqu’un d’autre. Une brèche s’ouvre toutefois sur sa souffrance. Avec beaucoup d’émotion, elle livre la question qui en somme motive sa demande. « J’ai peur de parler », dit-elle. « Je suis très timide ; peut-être que Peter est comme moi. J’en ai souffert. C’est pour cela que je veux l’aider. Je viens pour son bien. »
Nous voyons comment Peter est mis là en place de répondre au manque de sa mère, l’assignant à être comme elle : « Je le sens comme moi », dit-elle. L’enfant n’est pas séparé d’elle par le père qui, par sa conduite d’évitement des conflits, ne remplit pas sa fonction d’interdire l’enfant à sa mère. En n’établissant pas une médiation entre l’identification et la part prise, par l’enfant, dans le désir de la mère, le père laisse l’enfant ouvert à toutes les prises fantasmatiques et exposé au risque de devenir objet de la mère. Peter, quant à lui, trouve comme solution au symptôme familial le bégaiement qui dérange tellement ses parents qu’ils décident de venir en parler. La maman révèle ainsi des éléments importants de la petite enfance de son fils.
Le cri : risque de danger de mort
À sa naissance, Peter souffre de quatre hernies inguinales de la paroi abdominale. Il fallait absolument, dit sa mère, qu’il ne crie pas. Au lieu d’être signe de vie hors du corps maternel et de matérialiser la séparation entre l’enfant et sa mère, le cri résonne ici, pour l’entourage du nourrisson, comme un danger de mort : crier risque d’entraîner une éventration qui aurait mis en péril sa vie. L’enfant devient ainsi objet médical, objet de soins imposant à sa mère de répondre immédiatement à tout pour lui afin surtout qu’il ne crie pas. Au lieu d’expérimenter que par son cri il fait venir sa mère, transformant le cri en appel, l’enfant se trouve ainsi pris dans une relation quasi symbiotique avec sa mère qui garde le souvenir d’une tension terrible en elle, jusqu’à ce que Peter soit opéré à l’âge de trois mois. Il est également remarquable que cet enfant empêché de crier, donc de faire sortir sa voix, mettant en cause la pulsion invoquante, développe plus tard un autre mode d’inhibition de la pulsion par un retard de la parole puis par un bégaiement, installé au moment de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, qui fait crier sa mère, alors que son père n’aime pas élever la voix.
Encore actuellement, Peter mobilise l’énergie de sa mère à le faire travailler et à « mâcher son travail » ou bien focalise son attention sur lui quand il bute sur les mots en la regardant, « comme s’il attendait, dit-elle, que je dise pour lui. » La mère souffre de ce que ça le frustre : « Je veux toujours le porter ». Pour cet enfant surprotégé, l’entrée à l’école est vécue comme un « déchirement ». Les pleurs de Peter retournent sa mère, tandis que Peter est persécuté par les cris qu’il redoute quand il lit et écrit mal. Dans ces conditions, toute émission devient problématique, notamment l’émission verbale, et l’angoisse de castration est permanente dans le fait de parler.
Comment sortir de cette impasse où l’enfant est en position de répondre au manque de sa mère, tandis que celle-ci devrait combler l’enfant ? Dans le démarrage difficile du travail, nous repérons que c’est seulement à partir du moment où la mère installe du manque dans l’autre (« je ne suis pas celle qui convient à mon fils »), qu’alors elle pose autrement sa demande, s’avoue manquante, contrairement à la demande médicale, puis scolaire, qui lui impose de parer à tout.
L’équilibre familial bascule
Six mois après le début de la cure, Peter n’est plus l’enfant adorable décrit par le père. Il sème la brouille, embête son frère aîné en « criant », en le frappant, et l’empêche de travailler. La mère, décontenancée, se demande comment réagir. Si elle n’intervient pas pour rétablir le bon ordre, la tension monte. Par ailleurs, Peter s’oppose à sa mère, refuse de faire son travail le soir, joue, traîne. Désarçonnée, elle s’interroge : « Dois-je sévir ? » Tout en me confiant ses questions, elle m’annonce le souhait du père de me rencontrer.
Mise en cause du père
Il vient seul et manifeste son étonnement, sa surprise d’entendre son fils parler normalement lorsque, dit-il, « il sort de ses gonds avec son frère ». « Quand Peter ne se contient plus et laisse sortir son agressivité, il ne bégaye pas », constate le père qui ajoute cette remarque : « Peter est comme un légume dans une Cocotte-Minute sous pression. » La pression, le père la situe du côté de la mère exigeante, sévère. Il envisage, dit-il, « d’écarter les lignes jaunes pour donner plus d’espace à Peter ». Cette métaphore pointe la place que le père pourrait occuper auprès de son fils pour desserrer l’étau maternel et évoque celle, utilisée par Lacan, du rouleau de pierre dans la gueule du crocodile : « Un grand crocodile dans la bouche duquel vous êtes, c’est ça la mère. On ne sait pas ce qui peut lui prendre tout d’un coup, de refermer son clapet [7] » et le rouleau de pierre « qui est là en puissance au niveau du clapet, ça retient, ça coince. C’est ce qu’on appelle le phallus. C’est le rouleau qui vous met à l’abri, si, tout d’un coup, ça se referme [8]. » Autrement dit, commente Geneviève Morel, « le désir de la mère, c’est ce qui menace le sujet d’en devenir l’objet consommé [9] » et le phallus doit intéresser la mère, au moins suffisamment pour que l’enfant échappe partiellement au désir dévorant de sa mère. Pour cela, le Nom-du-Père intervient par l’inscription d’un signifiant qui installe la loi dans l’inconscient du sujet et fait surgir la signification phallique. L’interdit posé par le père – « Non, ta mère c’est ma femme et non la tienne » – détourne l’enfant de la mère et fait ainsi de celle-ci l’objet de son désir tout en interdisant à l’enfant d’occuper cette place. Cet interdit instaure la Loi primordiale de l’œdipe.
Ici, le père, mis en cause par le symptôme de son fils, s’interroge sur la place qu’il occupe dans le trio père, mère, enfant : « Est-ce que je devrais être plus autoritaire et ma femme moins ? Est-ce que cela ne viendrait pas de ce que je ne mets pas les points sur les i par peur des conflits ? Est-ce un problème avec l’autorité puisqu’avec son frère, Peter ose laisser sortir sa colère sans bégayer », contrairement au père qui, lui, préfère « s’écraser » au lieu de risquer un « clash » avec son épouse qui, ajoute-t-il, « monte tout de suite au créneau si je m’oppose à elle » ? Or, pour l’instauration du père de la Loi comme signifiant, Lacan met l’accent sur le cas que la mère fait, non pas de la personne du père, mais de sa parole et de la façon dont elle la répercute sur l’enfant. La mère, dans ce cas, par ses cris, fait taire le père qui lâche sa position pour sauvegarder sa tranquillité. Il se tait, laisse diriger sa femme plutôt que de faire taire la mère qui s’acharne à entretenir une dépendance de son fils à son égard, redoutant son autonomie puisqu’il est tout pour elle : objet d’amour, de soins, d’attention dévorante. Le père, par son questionnement, indique qu’il est conscient d’une carence de la fonction paternelle. Mais dans quelle mesure est-il prêt à changer de position, position que Lacan situe dans un certain « fermer les yeux », un juste « mi-dieu [10] » face à cette mère avide de réussite pour son fils ? Ainsi, quand celui-ci ramène un bon bulletin, la seule interrogation de la mère tourne autour de l’évaluation de l’impact du soutien scolaire auquel elle se consacre chaque soir auprès de son fils : Peter aurait-il eu d’aussi bons résultats sans son intervention ? La maîtrise de la réponse, toutefois, lui échappe.
Le rire et l’équivoque
Peter, de son côté, s’autorise, en séances, à relater quelques souvenirs où rires et agressivité s’entremêlent. Il évoque ainsi le chien de sa mère, un fox-terrier, « à la petite queue », précise-t-il, mordant la robe d’un curé puis le pantalon d’un policier. Ce récit le fait beaucoup rire et trahit par le rire qu’il suscite la rencontre avec l’objet, ici l’objet oral évoqué par la morsure du chien.
Le rire jaillit à une autre occasion où la mère se trouve là encore impliquée, un jour où elle s’apprête à s’engouffrer dans le bureau, prétextant que Peter a quelque chose à me dire. Je la renvoie donc poliment mais fermement dans la salle d’attente, afin de laisser la parole à son fils qui éclate en fou rire dès que sa mère a tourné les talons. Ce rire, imputé à l’effet soudain de séparation, s’assortit d’un soulagement pour l’enfant : « Je vais mieux, dit-il, je pense que je vais pouvoir bientôt arrêter de venir ici. » Il accepte pourtant de différer cet arrêt trop rapidement posé, probablement en écho à la culpabilité sous-jacente à l’égard de sa mère mise dehors et au plaisir qu’il en a retiré.
Viennent ensuite des récits de films où émerge l’équivoque
Premier récit : « Un braconnier emmène un bébé gorille dans un camion qui se renverse. Le gorille se sauve et arrive dans un village avec une fête foraine. Il sauve à son tour un enfant en haut d’une grande roue enflammée. L’enfant est vivant. »
Deuxième récit quelques semaines plus tard. « Un voleur de chien est poursuivi par la police. Dans la fuite du voleur, la cage du chien tombe et s’ouvre. Le chien libéré est recueilli par un monsieur qui colle des affiches avec la photo du chien pour tenter de retrouver son maître. » Mais, commente Peter, « peut-être que le maître ne l’a pas reconnu parce qu’il était bébé et qu’il est devenu grand. » Dans le récit, le monsieur devient le père « plus trop d’accord pour garder le chien. Ça se voyait à sa figure. Il l’a pas dit. » Je m’étonne de ce père qui n’ose pas dire. Surpris, Peter poursuit son récit : « Le chien est venu dans la chambre des parents sur le lit ; il s’est secoué ; il était tout sale. Le père l’a vu et l’a mis au chenil. » Je souligne l’intervention de ce père qui remet le chien à sa place. Perplexe, Peter est visiblement troublé d’avoir mis en scène un père qui ose s’affirmer en prenant sa place afin de remettre chacun à la sienne.
Conclusion
Le rire et l’équivoque du signifiant « sauve » signent, semble-t-il, le désir du sujet de s’extraire du filet de la problématique de ses parents. Malheureusement, la mère s’empresse de colmater la brèche. Elle ne veut plus entendre parler de tout cela et veut « tirer un trait sur le passé ». Sa détermination l’emporte. Elle n’accompagne plus son fils à ses rendez-vous. Le père, sollicité pour soutenir le travail en cours, décline la proposition et tire, une fois de plus, son épingle du jeu. Si, au terme de cette année de cure prématurément interrompue, Peter ne bégaye plus et ne garde de son symptôme qu’une expulsion d’air accentuée avant l’émission de certains mots, donnant au débit verbal une allure saccadée, en revanche, la problématique du père et de la mère reste entière. Peter semble toutefois aller mieux, probablement pour avoir pris de la distance par rapport à ses parents. Continuera-t-il sur cette lancée ?